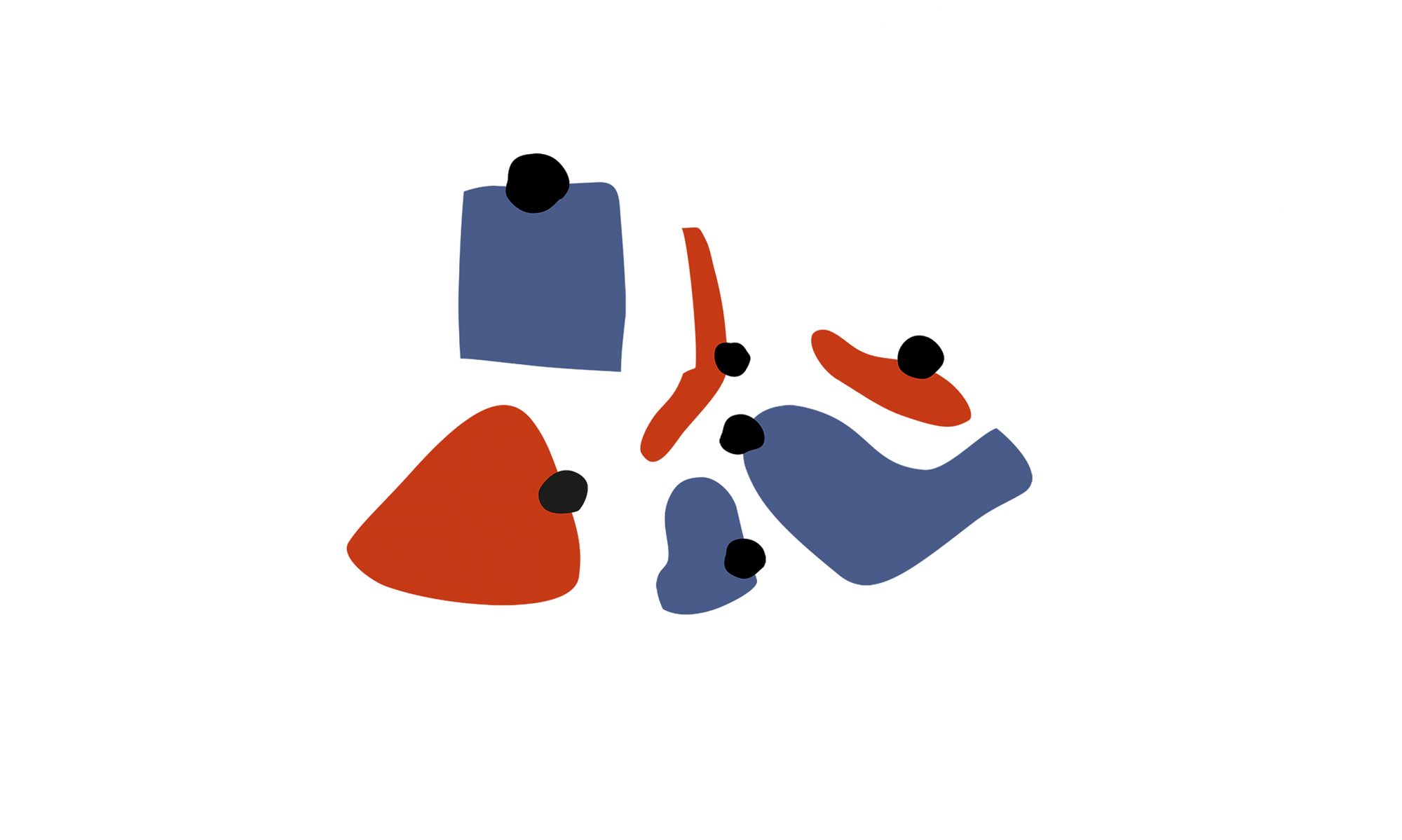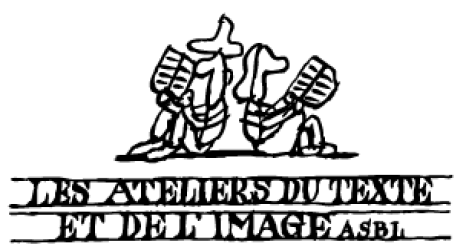Le texte de cet album transcrit le récit recueilli de vive voix par l’auteure américaine Ruth Vander Zee. Lors d’un voyage en Allemagne à l’occasion du cinquantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a rencontré de façon inopinée « Erika ». Profondément touchée par son courage et par l’espoir face à son vécu tragique, l’auteure eut besoin de l’écrire. D’autres histoires suivront car, dit-elle, « je crois que les enfants veulent entendre les vérités de la vie racontées d’une manière qui leur donne de l’espoir et du courage »1.
Dès leurs premiers échanges, il fut question de visites aux camps de Mauthausen et de Dachau. L’auteure cède alors la parole à Erika qui à l’âge de quelques mois seulement a échappé au sort de six millions de Juifs tués entre 1933 et 1945. D’un wagon à bestiaux aux portes verrouillées, mais par l’ouverture en haut de la paroi, « ma mère m’a jetée hors du train ». Un arbre généalogique mis en pièces en 1944… Jusqu’à cet instant-là, cette partie de sa vie sera pour elle un « blanc », un interminable champ de questions et de suppositions que l’imagination ne pourra jamais qu’évoquer sans les résoudre. Ils constituent la part la plus longue de ce récit. Nous apprenons que ce bébé fut ensuite confié à une personne bienveillante, qui lui donna le prénom d’Erika ainsi qu’une date de naissance, et risqua sa vie pour elle.
« Sur le chemin qui la menait à la mort, ma mère m’a lancée vers la vie » : c’est dans ces quelques mots que tient le destin d’Erika. Grâce au courage incommensurable de sa mère d’abord, grâce à celui extraordinaire de la personne qui a pris soin d’elle, grâce aussi à l’homme merveilleux qu’elle a épousé et à la famille qu’ils ont fondée, grâce enfin à sa force de résilience, Erika pourra affirmer « aujourd’hui, mon arbre a refait ses racines » .
Dans ce récit en « je », le sort individuel d’Erika est sans cesse relié à celui de son peuple tout entier : « entre 1933 et 1945, six millions de personnes de mon peuple ont été tuées », comme «il a été dit un jour que mon peuple serait aussi nombreux que les étoiles au firmament ».
La force de ce texte repose sur le style direct et sobre, où chaque mot est pesé, rien n’est superflu ou anecdotique ; les phrases sont courtes, centrées sur l’essentiel. « Je suis née un jour de 1944. Je ne sais pas la date de ma naissance. Je ne sais pas le nom qu’on m’a donné alors. Je ne sais pas dans quelle ville ni dans quel pays je suis née. Je ne sais pas si j’ai eu des frères ou des sœurs. Ce que je sais c’est que, âgée de quelques mois seulement, j’ai échappé à l’Holocauste… ».
Roberto Innocenti prend le relais pour reconstituer en images les scènes que ne décrit pas le texte. Ainsi cette file compacte d’adultes de tous âges, têtes baissées, dos voûtés, accompagnés d’enfants ; ils sont serrés dans leur manteau arborant une étoile jaune et portent à bout de bras des balluchons plus nombreux que des valises ; encadrés de soldats bottés, casqués, armés, ils gagnent un wagon dont on comprend à l’absence de fenêtres qu’il n’est pas destiné à des humains. Le regard du spectateur est d’abord focalisé sur cette file humaine par les deux lignes obliques que constituent d’une part la suite des wagons et d’autre part le bâtiment austère de la gare, mais le regard butte à l’avant plan sur une large barricade de planches et de barbelés qui à la hauteur des visages cache ceux-ci au profit d’un mot en grands caractères « Verboten ». Alors même qu’elles sont hyperréalistes, les illustrations de Roberto Innocenti partagent les mêmes qualités que le texte : respect, pudeur, sensibilité et sobriété.
On soulignera de plus le choix des couleurs. Correspondant à l’atmosphère du contexte, l’ensemble est en noir, gris et blanc mis à part quelques détails significatifs de couleur claire – les baluchons, l’étoile jaune cousue sur les vêtements, un landau abandonné sur le quai… Si cette dernière image provoque notre effroi, la suivante crée un véritable choc : couleur rose de la couverture enveloppant, bien serré, le bébé que deux mains lâchent par une petite ouverture dans la paroi du wagon. Il y a dans cette couleur rose tout l’espoir, toute l’ouverture à la vie qu’offrent les deux mains qui s’éloignent avec le train.
Par contraste, sont entièrement en couleurs les pleines pages du début – la rencontre de l’auteure et d’Erika en 1995 – et la dernière page où une fillette regarde au loin passer un train tandis qu’une personne fait sécher du linge près d’une maison de village, tranquille.
J’avais découvert cette histoire en 2003 quand elle fut publiée par les éditions Milan sous le titre « L’étoile d’Erika », texte traduit par Emmanuelle Pingault. Je la retrouve publiée en 2017 par les éditions d2eux qui ont confié la traduction à Christiane Duchesne, choisi un papier mat et grisé, modifié certains découpages d’images, supprimé les bordures des illustrations au profit de pleines pages, élargissant ainsi le hors champs. La typographie fine et noire remplace celle de l’album antérieur. La mise en page diffère également.
Je ne me hasarderai pas à une appréciation qualitative des deux présentations car je pense que l’ensemble des choix de chaque éditeur est justifié dans sa cohérence. L’impact émotionnel de chacun des deux albums est une question de sensibilité personnelle.
Chantal Cession
1. Entretien publié sur le site web Eerdmans Books for Young Readers