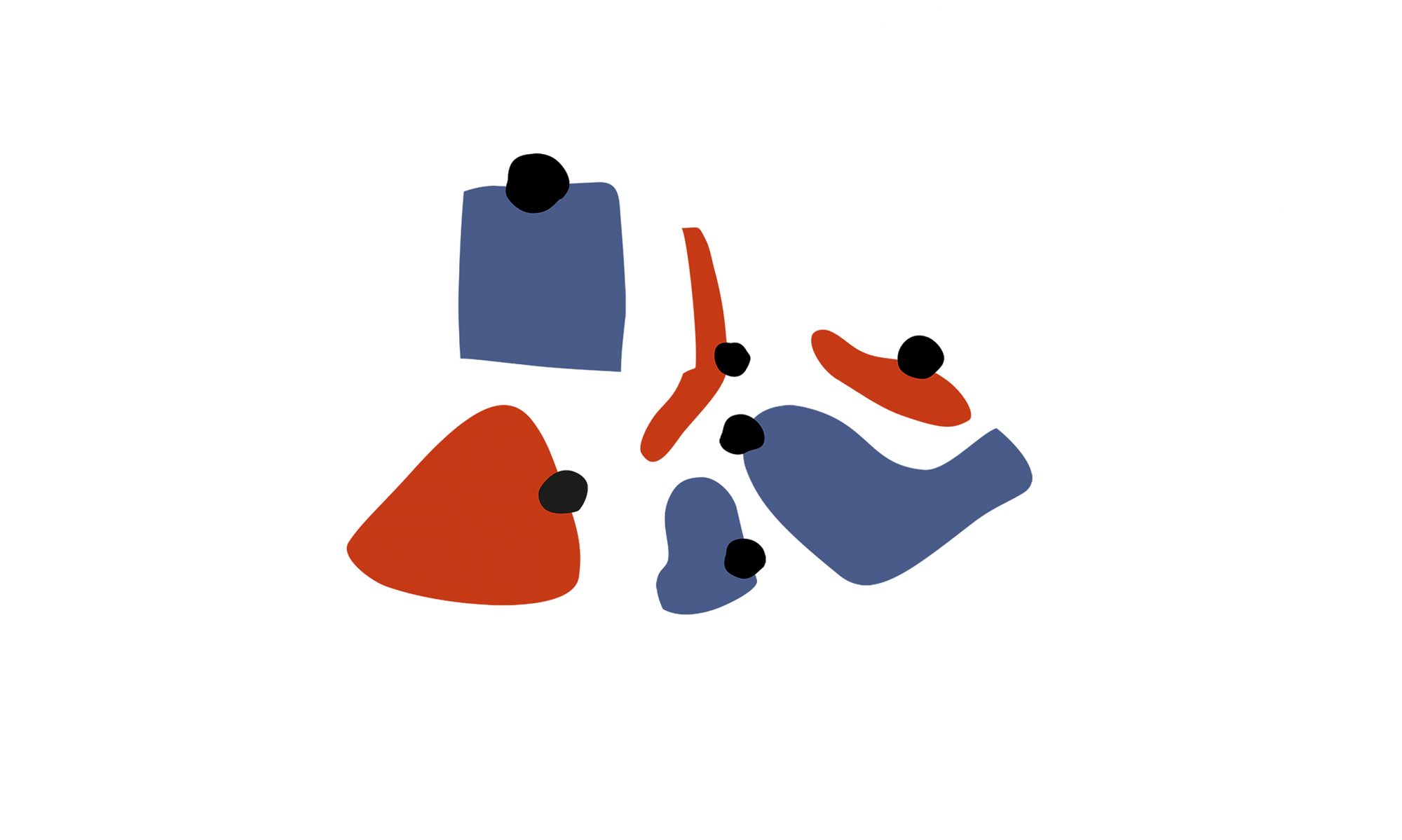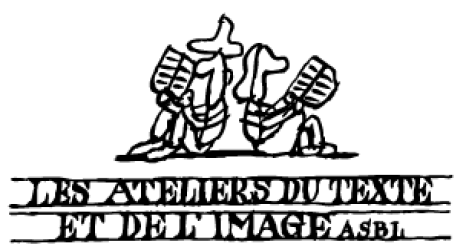Pour rendre hommage à Tomi Ungerer qui vient de nous quitter, les ATI ont décidé de publier in extenso la conférence de Michel Defourny, « Tomi Ungerer ou l’art de la provocation », présentée à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, lors de la journée d’étude consacrée à l’artiste en janvier 2009, à laquelle participait également Thérèse Willer, directrice du Musée Ungerer de Strasbourg. Des extraits de cette conférence sont parus dans la revue Lectures (numéro 193, novembre-décembre 2015). On a volontairement conservé le caractère oral de l’exposé. Les albums parus après 2009 ne sont évidemment pas pris en compte.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais remercier le Centre de Littérature de jeunesse de la Ville de Bruxelles, Monsieur l’Inspecteur Malfait et Luc Battieuw qui m’ont invité à participer à cette manifestation, dans le cadre de l’exposition Tomi Ungerer. C’est avec plaisir que je me retrouve ici à l’Hôtel de Ville où j’ai eu l’occasion d’intervenir jadis dans le cadre des Séminaires Paul Hurtmans.
Luc Battieuw m’a demandé de traiter des livres pour enfants de Tomi Ungerer, l’un des « monstres » de la littérature de jeunesse qu’il a contribué à transformer. Articles, colloques, études, doctorats ont été consacrés à son œuvre. C’est très modestement que j’apporterai ma contribution de lecteur, séduit par son oeuvre depuis 1968, d’autant plus modestement que nous avons aujourd’hui l’honneur d’accueillir Thérèse Willer, la plus compétente des spécialistes de Tomi Ungerer.
Je parcourrai avec vous quelques-uns de la première série des albums pour enfants publiés en français. Nous ne traiterons donc pas du Tomi Ungerers Märchenbuch publié en 1975 chez Diogenes, à Zürich, dans lequel l’auteur revisite six contes qu’il aime particulièrement comme Le Briquet d’après Andersen ou Le Petit Chaperon rouge, qui se termine par les épousailles du chaperon et du loup. Ni du Grosse Liederbuch, Le grand livre des chansons, sur lequel Tomi Ungerer travailla sept ans, lorsqu’il séjournait au Canada.
En d’autres mots, l’essentiel de l’intervention consistera en une lecture des albums publiés en France entre 1968 et 1974. Tomi Ungerer avait annoncé en 1973, après la publication d’Allumette, qu’il renonçait à la littérature de jeunesse : « J’ai conçu mon dernier livre pour les enfants car j’ai douté de la nécessité de continuer. »
C’est avec ces titres publiés en édition originale entre 1961 et 1974 qu’il a contribué à changer le paysage du secteur. Tandis que ces titres inquiétaient les parents, leur auteur n’hésitait pas, dans ses déclarations tonitruantes, à les inquiéter plus encore en jouant la carte de la provocation.
« Je suis un agent provocateur. Je donne aux enfants les moyens, en développant leur imagination, de provoquer les adultes. » a-t-il écrit.Des propos qu’il complète : « Si j’ai conçu des livres pour enfants, c’était d’une part pour amuser l’enfant que je suis et d’autre part, pour choquer, pour faire sauter à la dynamite les tabous, mettre les normes à l’envers ; brigands et ogres convertis, animaux de réputation contestables réhabilités… Ce sont des livres subversifs, néanmoins positifs. »
Je serai bref par rapport à ce que je pourrais appeler la période américaine et par rapport à la production récente puisque, à partir de 1997, à la surprise générale et pour le plus grand plaisir des lecteurs, Tomi Ungerer a entrepris un nouveau cycle, sous le signe de la tolérance. Et du respect de l’autre.
Comme convenu, je négligerai la biographie de l’auteur et je ne ferai pas référence aux autres facettes de la création de l’artiste, la publicité et les posters, les dessins d’observation, les dessins satiriques, les dessins érotiques, pour reprendre la classification de Thérèse Willer, dans son important ouvrage intitulé Musée Tomi Ungerer, la collection, paru à Strasbourg, fin 2007.
Il faut savoir d’entrée de jeu, que les albums pour enfants de Tomi Ungerer sont inépuisables et que toute lecture est inévitablement incomplète. Et que toute lecture se fait interprétative. Tomi Ungerer est un maître de la suggestion, ses œuvres « ouvertes » laissent une très grande place au lecteur, quel que soit son âge.
Les Trois Brigands
Nous étions en 1968. Chez quelques libraires, on pouvait voir un album dont les couleurs de la couverture tranchaient sur la production générale. Du noir, beaucoup de noir, du bleu nuit, beaucoup de bleu, du rouge, une touche de vert, très discrète. C’est à la librairie de François Maspero, à Paris, dans le Quartier latin, que j’ai vu cet album étonnant, au moment de sa sortie. Je fus immédiatement conquis et j’ai acheté l’ouvrage sans hésitations, me réjouissant d’avance de la parution des titres suivants.
On distinguait trois personnages à grand chapeau, au visage dissimulé derrière un aplat noir ondulant qui pouvait être interprété comme une cape. Les trois brigands étaient identiques. Trois, nombre de la totalité s’il en est un, comme les trois Parques, les trois Grâces, les trois Rois Mages, les trois Mousquetaires, comme de nombreuses triades religieuses ou mythologiques. Un seul détail les distinguait, le cordon de couleur verte qui ornait les hauts chapeaux. La couleur de leur visage sur laquelle se détachait le blanc des yeux, aux pupilles noires, était le bleu nuit qui constituait le fond de page. On apprendra dans la suite de l’histoire que chacun portait une arme différente.
Une hallebarde, dont les lames latérales étaient rouge sang, dominait les personnages, à la façon d’un étendard ou d’un drapeau. Immobiles, le regard fixe, les personnages semblaient… guetter… attendre… prêts à passer à l’action.
Le titre de l’album et le nom de l’auteur apparaissaient au bas de la couverture en lettres capitales : blanches et de grand format pour le titre, jaunes et en caractères plus réduits pour le nom de l’auteur.
Si Tomi Ungerer avait publié aux Etats-Unis plusieurs albums qui furent ultérieurement traduits, si Les Trois Brigands était paru à Munich chez Georg Lenz Verlag en 1961, puis chez Diogenes à Zürich, son nom était inconnu du grand public de langue française.
Pour publier ce titre en France, il avait fallu l’audace conjointe de Jean Fabre et d’Arthur Hubschmid de L’école des loisirs.
Un détour par L’école des loisirs
L’école des loisirs était à l’époque une jeune maison d’édition fondée par Jean Fabre et Jean Delas. Avant de devenir la maison que nous connaissons, celle de Leo Lionni, d’Arnold Lobel, de Iela et Enzo Mari, de Maurice Sendak, de Philippe Dumas, de Grégoire Solotareff, de Claude Ponti, de Catherina Valckx, d’Yvan Pommaux… cette entreprise familiale était spécialisée dans le manuel scolaire : elle s’appelait les Editions de l’Ecole.
Les Editions de L’Ecole étaient spécialisées entre autres dans la publication de catéchismes. Mais une rupture était intervenue en 1965. A la suite d’une visite à la Foire de Francfort, Jean Fabre accompagné par un jeune stagiaire suisse, Arthur Hubschmid, originaire de Zürich et dont la langue maternelle était l’allemand, avait découvert le dynamisme de l’édition internationale pour la jeunesse.
Je cite Arthur Hubschmid : « Un jour Jean Fabre s’était aperçu qu’il existait une foire du livre à Francfort. Je ne sais pourquoi il avait décidé que c’était intéressant pour lui ou pour sa maison d’aller à Francfort, parce que les livres scolaires, ça ne s’exporte pas, ça ne s’importe pas (…). Donc, on était à Francfort, à la Foire du livre. On se promenait, on regardait les choses (…). On s’emmerdait comme des rats parce que, évidemment, on n’avait rien à faire là, si ce n’est regarder les stands. Et regarder les stands d’éditeurs scolaires, c’est très ennuyeux. Alors du coup, je ne sais plus comment, on s’est dit : « On pourrait regarder des livres pour enfants ».
Donc « livres pour enfants » – révélation – parce que je n’avais jamais vu de livres pour enfants de ma vie (…) . Je n’avais jamais « lu » un livre pour enfants. (…) Donc, on se promène, et là je découvre parce que j’étais un petit peu plus versé en allemand et en anglais que mon patron, je découvre des éditeurs américains comme Viking, Harper and Row (…) Ou des anglais comme Jonathan Cape, Bodley Head, etc. qui étaient des éditeurs littéraires très respectables… Comparables à ce que nous avons chez nous, avec le Seuil, Albin Michel, Gallimard – et que des noms pareils avaient, à côté, un département jeunesse dans le même stand.
(…) Moi, j’étais surtout intéressé par le dessin, le graphisme, par l’esthétique de livres. Alors là, je découvrais des trucs à l’italienne, très haut, très larges, presque triangulaires… des choses qu’on ne voyait jamais en France. Et je ramassais ces trucs-là parce que les éditeurs américains étaient très libéraux (…), une dizaine, une quinzaine de titres chez ces gens-là , mais aussi chez les Scandinaves. Il y avait là Bonniers, Räben &Sjögren… En Suisse, il y avait Diogenes qui faisait des livres essentiellement importés des Etats-Unis. C’est Daniel Keel qui a importé le premier Tomi Ungerer des Etats-Unis, je l’ai découvert plus tard, et il a été publié en Suisse pour l’Allemagne et ensuite Sendak, etc. »
A leur retour, Jean Fabre confie à Arthur Hubschmid la responsabilité d’un département jeunesse qu’il baptise « L’école des loisirs ». En intégrant le mot « école » dans le nom de la nouvelle branche de sa maison, Jean Fabre fait certes écho aux Editions de l’Ecole et à leurs manuels scolaires, mais il entend surtout donner au « livre pour enfants » un statut de respectabilité et de sérieux que les adultes ne reconnaissaient guère à l’époque aux livres d’images et aux albums. Seuls les livres d’apprentissage trouvaient grâce à leurs yeux, les autres n’étaient que passe-temps futile. Ce livre passe-temps, expliquait le directeur de L’école des loisirs, était considéré comme un livre qui ne sert à rien, un objet de consommation acheté uniquement en fonction de son prix.
A partir de 1965, Jean Fabre fit le grand écart entre le manuel normatif et l’album de jeunesse. Réfléchissant à ce qu’était « la lecture », il se mit à souhaiter que l’enfant dépassât la lecture « orthodoxe » du message qu’attendaient les enseignants de l’époque. Selon lui l’album devait permettre au lecteur quel que soit son âge d’accéder à une « lecture interprétative », celle que préconisent de nombreux pédagogues d’aujourd’hui.
Les choix éditoriaux d’Arthur Hubschmid avalisés par Jean Fabre ne rencontrèrent pas immédiatement de succès. Mais le poids des commerciaux n’était guère aussi lourd dans les années soixante qu’aujourd’hui. On donnait à chaque titre le temps de vivre, d’autant qu’il fallait travailler à un changement de mentalité.
On pouvait prendre des risques en publiant des ouvrages audacieux à condition que d’autres permettent leur financement. Si la mémoire d’Arthur Hubschmid ne lui joue pas de tours : l’année de sa publication, il ne s’est vendu, pour la France et la Belgique, que 823 exemplaires des Trois Brigands.
Par contre, Les Trois Brigands correspondait tout à fait à l’optique de la jeune « école des loisirs » : une œuvre de création qui suscite une émotion esthétique, un album qui invite à la lecture interprétative, un livre qui interpelle le lecteur et provoque ses réactions, un titre à partir duquel l’enfant éprouve l’envie de s’exprimer, qu’il ressente de le frémissement de la peur ou l’excitation du plaisir, un livre destiné d’abord aux enfants, quitte à ce qu’il déplaise aux parents.
Retour aux Trois Brigands
Revenons-en, après ce détour par l’éditeur et à ses choix, à l’album des Trois Brigands, qui a été édité, en 2008, en format géant, en même temps qu’un film en était tiré par Hayo Freitag.
Si les ventes n’ont pas été meilleures en 1968, c’est probablement parce que l’album inquiétait pas mal d’adultes. Ceux-ci craignaient que les trois malfaiteurs tout de noir vêtus ne terrorisent les enfants, les poursuivant dans des cauchemars.
D’après le témoignage de Véronique Lory, libraire de jeunesse, certains de ses confrères refusèrent même ce livre.
Ici encore, il me faut insister sur l’air du temps. Beaucoup de prescripteurs considéraient que l’enfant devait vivre « sa vie d’enfant », autrement dit, que les enfants devaient vivre dans une bulle d’insouciance, protégés des réalités de la vie, et qu’il fallait leur éviter des histoires violentes ou trop proches de la dure réalité.
A cette époque, on hésitait à leur raconter les contes dans leur version originale. Les récits de Charles Perrault et des frères Grimm, comme ceux de Hans Christian Andersen étaient censurés parce qu’ils paraissaient traumatisants. Bruno Bettemlheim et son Uses of Enchantment, traduits en 1976 chez Robert Laffont sous le titre Psychanalyse des Contes de fées, n’étaient pas encore passés par là.
Comme les contes étaient trop célèbres pour que l’on s’en passât, l’édition commerciale les corrigeait. Par exemple, la grand-mère du Chaperon rouge avait échappé au loup en se cachant dans un placard ; elle n’avait donc pas été dévorée. Que du contraire ! L’animal avait été assommé par la vieille dame énergique qui lui avait asséné par surprise un bon coup sur le crâne.
Après s’être débarrassé de lui, dans la chaumière coquette, la Mère Grand et la fillette avaient fait la fête, se régalant des galettes délicieusement cuites par la gentille maman du petit chaperon.
Pas plus que les terribles monstres de Max et les Maximonstres de Maurice Sendak, les brigands de Tomi Ungerer effrayaient-ils les enfants ? Même au moment où ils s’avancent l’un derrière l’autre, en une superbe diagonale, enroulés dans leurs grands manteaux et où l’on les croirait prêts à sortir du livre tant ils s’approchent du lecteur dans cette page à bord perdu.
Les brigands… effrayaient-ils réellement les enfants lorsque ceux-ci voyaient leurs armes vieillottes. Si vieillottes et si cocasses que l’on pouvait douter de leur efficacité.
Les brigands… effrayaient-ils réellement les enfants lorsque les voyageurs détroussés prenaient la fuite ou s’évanouissaient ? Ou au contraire s’amusaient-ils de la panique des grands, alors qu’aucun signe d’effroi ne se lit sur le visage de la petite Tiffany, réjouie au contraire d’échapper à son destin d’orpheline qui la condamnait à une vie morne auprès d’une vieille tante grognon ?
La peur au cœur de l’album
Admettons cependant que les brigands aient pu effrayer certains lecteurs. Nous redoutons, tous, les voleurs qui font alliance avec la nuit pour nous dépouiller de nos biens. Mais notons que Tomi Ungerer donne des outils de distanciation : un soufflet à poivre pour faire éternuer les chevaux, voilà qui ne manque pas d’humour ! Notons également que, dans le récit de Tomi Ungerer, les malfaiteurs ne pratiquent aucune agression corporelle.
Lorsqu’ils enlèvent Tiffany aux boucles aussi dorées que l’or qu’ils recherchent, c’est avec une grande douceur, avec tendresse même, qu’ils l’emportent.
Admettons que l’enlèvement de la fillette suscite de l’effroi, si l’on s’en tient strictement au fait – « un rapt » – sans tenir compte de la suite réconfortante de l’histoire. Puisque celle-ci raconte comment Tiffany a pris le pouvoir et a métamorphosé les trois gredins en assistants sociaux.
Assistants sociaux qui convertissent un « magnifique château » en un orphelinat pour enfants abandonnés.
Tomi Ungerer a confié à Arthur Hubschmid que son album était en quelque sorte une façon de raviver une peur enfantine personnelle, d’en jouir, et surtout de la transmettre :
« Quand j’étais petit, on avait un album de Bécassine, où l’on voyait un cambrioleur avec une lampe sourde, et qui entrait dans la maison. A cinq ans, ça m’avait foutu une trouille terrible. J’ai gardé de cette trouille un si bon souvenir que j’ai voulu donner cela aux enfants. »
Par-delà cette trouille, dans Les Trois Brigands, Tomy Ungerer a donné bien d’autres choses aux enfants : un récit plein de rebondissements et qui se termine positivement.
En commençant son récit par « Il était une fois », il indique clairement qu’il s’inscrit dans la tradition du conte, récit ouvert à l’interprétation, qui présente souvent le cas d’enfants qui, quoique en situation désespérée, triomphent de l’adversité, qu’il s’agisse du « Petit poucet » confronté avec ses frères à la grande forêt, puis à l’ogre, qu’il s’agisse de « Hansel et Gretel » qui éliminent la sorcière…
De nombreux contes donnent confiance en la vie et montrent que jamais un destin n’est tracé d’avance et que si le héros ou l’héroïne font preuve d’imagination, de ruse, d’initiative et d’intelligence, ils sont capables de changer le cours des événements.
L’album s’impose également sur le plan artistique, les couleurs, noir et bleu sur lesquels tranche l’éclat de l’or créent une atmosphère rarement rencontrée dans un album pour enfants. La stylisation des formes et les variations qu’elles permettent traduisent la « conversion » qui a été opérée : chapeau des brigands, chapeau des orphelins, toiture des tours de la ville …
J’ajouterai enfin que, dans ses investigations, Thérèse Willer considère que Tomi Ungerer « a usé d’un graphisme très japonisant (…). L’ondulation des trois chapeaux des brigands sur l’image de couverture – écrit-elle – qui évoque le mouvement de La Vague de Hokusai, est peut-être un clin d’œil de l’auteur à l’un de ses artistes préférés. »
Le Géant de Zéralda et Allumette
Si Les Trois Brigands ont été mal accueillis par de nombreux adultes, les critiques se firent plus vives encore lors de la parution des titres suivants : Jean de la lune, Le Géant de Zéralda et Guillaume l’apprenti sorcier.
La Revue des Livres pour enfants cite l’une d’entre elles, dans un article intitulé « Ces livres qui ne plaisent pas aux parents ». A vrai dire, la revue reprend comme titre de l’article une expression de Tomi Ungerer lui-même, à propos de ses propres livres.
« Les images de Tomi Ungerer par leur agressivité réaliste et voulues par l’illustrateur (sans doute en proie à des problèmes non résolus) ravivent et même créent chez les enfants des fantasmes fort angoissants : fantasmes de dévoration, de castration, d’agressivité et sexuels (…). Les contes de fées s’adressent à ces fantasmes de manière symbolique, mais jamais de façon aussi crue, aussi cruelle et sadique ».
« Où est la truculence saine et gaillarde de Rabelais dans un conte d’un auteur qui semble avoir bien besoin d’un bon analyste freudien ! Certes la littérature pour enfants s’enrichit en trouvant des formules neuves, mais pas en abreuvant les enfants des expressions de déséquilibre intérieur. Voir aussi les dessins de l’apprenti sorcier du même Ungerer… »
J’ouvre une parenthèse à propos de cette citation, je me demande si l’auteur de cette critique acerbe a jamais lu Rabelais dont la verve truculente pourrait éveiller pas mal de fantasmes ! Je ferme la parenthèse.
Le Géant de Zéralda
Le Géant de Zéralda est paru chez Diogenes en 1967, et c’est le troisième album d’Ungerer paru en France, en 1971. Ce titre, comme nous l’avons déjà signalé, a scandalisé nombre d’adultes. Il est vrai que les premières illustrations de l’album sont effrayantes.
La couverture donnait le ton, mais le côté terrifiant du personnage au visage agressif, aux bras musclés, avec son grand couteau, était atténué par la présence sereine de la fillette qui sourit avec un air malicieux, comme pour dire : « cause toujours, on verra bien » . Par contre, lorsque l’histoire commence : « Il était une fois un ogre, un vrai géant, qui vivait tout seul… », l’image est terrible, aussi terrible que celle de Gustave Doré, qui, dans Le Petit Poucet de Charles Perrault, montre l’ogre prêt à trancher la gorge de ses petites filles endormies. Faut-il rappeler que lorsque les illustrations de Gustave Doré furent publiées en Angleterre, celles-ci furent censurées. De part et d’autre, chez Doré comme chez Ungerer, le couteau menaçant impressionne par sa taille, de même que la méchanceté qui se dégage des traits de l’abominable personnage.
Les adultes furent inquiets. Les jeunes lecteurs ne seraient-ils pas traumatisés. Par contre, si l’on en croit le témoignage des bibliothécaires, il aurait d’emblée passionné les enfants. C’est que l’ogre est une figure familière et redoutée comme le loup ou la sorcière. Il suscite, certes, la peur, mais dans la tradition des contes que respecte à sa façon Tomi Ungerer, les enfants savent que, le plus souvent, il est rendu inoffensif ou tout simplement éliminé par le héros du récit raconté, quels que soient ses méfaits antérieurs.
Quelques années plus tard, en 1986 et 1987, Grégoire Solotareff mettra en scène, à son tour, un ogre à la barbe rousse et si touffue qu’elle lui mange presque le visage. Dans Une prison pour Monsieur l’Ogre, Monsieur l’Ogre et la rainette, Monsieur l’Ogre est un menteur, les animaux de la forêt qu’il ravageait unissent leur force et se débarrassent du prédateur vorace.
Tomi Ungerer se débarrasse d’une autre façon de l’ogritude de son personnage et de sa voracité brutale. Ici, comme dans Les Trois Brigands, c’est une fillette qui opère la transmutation de l’animalité de l’amateur de chair fraîche et crue en un fin gourmet qui se délecte de plats finement cuisinés dont quelques-uns aux saveurs alsaciennes, comme la choucroute et ses saucisses, ces dernières si présentes dans l’ensemble de l’œuvre, dans Allumette par exemple ou dans Guillaume l’apprenti sorcier. Ces plats sont présentés avec délicatesse et raffinement, même si leur nom évoque quelquefois des souvenirs pour le moins ambigus : « Dinde jeune fille », « Croque fillette, sur délice des ogres ». Voyez l’humour noir dans la décoration de certains d’entre eux, le nœud rose et les deux petites chaussures rouges qui ornent la « dinde jeune fille ». Elles me rappellent personnellement les deux petites chaussures rouges de l’histoire de Pauline et les allumettes du Struwwelpeter du Docteur Hoffmann.
Et la brute, au terme du parcours, se fait douce, comme le prouve un sourire béat presque édenté et la peau lisse et rose de ses joues, presque aussi roses que celles de sa tendre épouse.
Tout est bien qui finit bien puisque des noces, apprend-t-on, ont été célébrées. La cuisinière et l’ogre se sont épousés et les enfants ont commencé à naître. A la fin de l’album, nous en sommes à quatre, déjà… mais nous sommes certains que d’autres suivront, comme il se doit, dans un conte.
La dernière page montre une famille heureuse avec un papa bien rasé, une maman belle à croquer, qui, pour mieux intérioriser son bonheur, ferme les yeux, son dernier né dans les bras. Trois enfants déjà grands se pressent autour d’eux.
Tout serait-il « rose » désormais comme le laisse supposer la guirlande fleurie qui entoure le portrait de famille ?
Attention, n’allons pas trop vite en interprétation, regardez bien ce que cache l’un des enfants, derrière son dos. L’histoire n’est-elle pas un perpétuel recommencement !
Claire Hirner qui a apporté sa contribution à l’ouvrage déjà cité de Thérése Willer, Musée Tomi Ungerer, la collection, explique comment l’artiste a créé ses images : « Il emploie un procédé particulier, fréquent à l’époque dans la littérature enfantine et dans la bande dessinée, et qui nécessite plusieurs étapes préparatoires. Après avoir tracé le contour du dessin à l’encre de Chine sur papier calque, une fine impression sur papier calque – ou sur rhodoïd dans certains cas – en est réalisée, elle est ensuite mise en couleur par l’artiste avec des aplats d’encres. Les deux feuilles superposées pour l’impression finale offrent alors une plus grande netteté visuelle. »
Pas de baiser pour maman
Entre temps, un petit livre était paru en 1973, chez Harper and Row, un petit livre qui se distingue des albums. Pas de baiser pour maman est dessiné au crayon noir uniquement et c’est d’après Ungerer lui-même le plus autobiographique de ses livres. Un chaton essaie d’échapper aux baisers d’une maman trop envahissante.
« Je ne supportais pas que ma mère m’embrasse ou me touche. »
Se confiant à Arthur Hubschmid, Tomi Ungerer lui disait par ailleurs : « Il faut que je te dise que No kiss for Mother, c’était une réponse à Maurice Sendak et à son Kiss for Little Bear, j’ai fait exprès de faire l’opposé. J’aime bien faire des blagues comme ça pour rigoler. »
Le petit livre fut accueilli très diversement. On lui décerna le « Prix du livre le plus nul ou le plus foireux de l’année » (Dud Award). Deux images dérangeaient les censeurs, celle où le petit Jo lit aux toilettes, une BD dans une main et, dans l’autre, sa brosse à dent. La seconde image à exciter l’ire des bibliothécaires américains, c’est celle où l’on peut voir une bouteille de Schnaps sur la table.
Allumette
Je voudrais à présent, sans nous soucier de la chronologie des parutions, aborder un autre album dérangeant, paru en 1974, dans lequel, une fois de plus, une fillette lutte contre son destin et, par-delà, influence le cours des événements par son engagement social.
Un destin que la littérature a figé sous la plume de l’un des grands conteurs de la littérature occidentale. Un destin tragique, celui d’une pauvrette, comme Hans Christian Andersen en a connu dans son enfance, lui qui appartenait presque au « lumpenproletariat », ce « sous-prolétariat en haillons » écrasé par la misère noire, méprisé ou ignoré par la bonne société d’alors.
On connaît La petite fille aux allumettes, qui continue à fasciner les auteurs contemporains, de Georges Lemoine à Sarah Moon. On se souvient du froid dont elle souffrait, des allumettes à vendre pour échapper aux coups que lui donnerait son père si elle rentrait à la maison sans argent. On se souvient des allumettes qu’elle enflamma pour se réchauffer, des vœux qu’elle formula et des visions qui s’en suivirent. On se souvient de sa montée au ciel, à la rencontre de sa grand mère. On se souvient qu’on la retrouvât morte… de froid, le lendemain.
Tomi Ungerer , comme le fera ultérieurement Georges Lemoine, actualise le récit. Dans une première version, parue en 1978, dans la collection « Enfantimage » chez Gallimard, Georges Lemoine a situé l’action dans les années cinquante, à l’époque où des bidonvilles ceinturaient Paris. Dans une seconde version parue chez Nathan, en 1999, La petite fille aux allumettes est devenue fillette bosniaque dans une ville assiégée entre 1992 et 1995.
En page de titre, Tomi Ungerer dresse des compliments à Hans Christian Andersen, aux frères Grimm et à Ambrose Bierce, un auteur qu’il découvrit lorsqu’il vivait aux Etats-Unis et dont il apprécia l’humour acide. Thérèse Willer a identifié le conte satirique d’Ambrose Bierce, The Little Story, dont le style – écrit-elle – a largement inspiré les illustrations d’Ungerer.
Avec Allumette, nous sommes probablement dans les années cinquante ou soixante, au moment où l’Europe d’après guerre retrouve la prospérité et où s’installe la société de consommation. Ce sont aussi des années au cours desquelles les sans-abri se font de plus en plus nombreux. On se souvient des rigueurs de l’hiver 1954. Cette année-là, l’abbé Pierre lança son appel sur les antennes de Radio-Luxembourg.
Moyennant cet écart dans le temps, perceptible dans l’écriture comme dans les images, Tomi Ungerer se fait, au départ, proche du conte d’Andersen, même s’il travaille la brièveté du texte et emploie des mots durs, très durs.
« Allumette était vêtue de haillons. Elle n’avait ni parents ni maison.
« Allumette cherchait sa nourriture dans les poubelles. Elle trouvait un abri sous les portes cochères et dormait dans des voitures abandonnées.
« Pour gagner quelques sous, elle proposait des boîtes d’allumettes… que personne ne voulait acheter.
« Regardez cette gamine, disait-on, en la montrant du doigt.
« Elle devrait vendre des briquets, ou des fleurs rares, mais pas des allumettes !
Personne n’a besoin d’allumettes ! »
En sœur des « Effarés » d’Arthur Rimbaud qui collaient leurs « petits museaux roses » au « grillage de la cave du boulanger », lorsque celui-ci sortait du four « les pains dorés à la croûte parfumée », Allumette écrasait son nez contre la vitre de la pâtisserie de Monsieur Lacroûte.
Une fois de plus, Tomi Ungerer donne des adultes une image négative. Ce ne sont ni des ogres, ni des brigands qui menacent l’enfant. Ce sont des commerçants, que n’émeut pas la maigreur de l’enfant, ni ses yeux arrondis creusés par la faim, ni ses guenilles qui ne la protègent pas du froid, en cette veille de Noël. Une fête qui aurait dû les inciter à la générosité et au partage. Le pâtissier se fait violent et vulgaire.
« Monsieur Lacroûte , le pâtissier, sortit en hurlant », dit le texte.
Le pâtissier hurle, comme le faisait le chef de la police militaire dans Jean de la lune.
« Fiche le camp ! Sale gosse !
Enlève tes pattes de ma vitrine
Ou je vais t’aplatir avec mon rouleau ! »
C’est à partir de ce moment que l’auteur s’écarte de la version originale du conte, en le détournant. Il refuse la fin désespérée. Loin d’être des visions qui ne sont qu’illusions fugitives, la magie opère. La réponse aux vœux de la fillette « est » réalité : c’est un vrai gâteau d’anniversaire, puis de « vraies » grosses dindes, puis un collier de saucisses bien réel, puis une pluie d’objets les plus hétéroclites qui tombent du ciel.
« Tout ce qu’avait pu souhaiter Allumette dans ses rêves les plus étranges, tout, absolument tout, déferlait autour d’elle. »
Electroménager, boustifailles et cochonnailles, jouets, équipements sanitaires, vêtements, mobilier… s’abattent sur terre en véritables cataractes, tandis que des éclairs illuminent la nuit.
Comme les misérables de la ville… mutilés, estropiés, sans travail, aveugles… se rassemblent pour recueillir la manne céleste qu’Allumette a l’intention de distribuer, le maire alerte la brigade d’intervention contre les émeutes, avant de tenter de récupérer l’affaire à son profit. Dans la foule, s’étaient glissées deux personnes bien peu sympathiques, non des malfaiteurs mais des minables qui avaient voulu profiter de l’aubaine.
Vous avez deviné de qui il s’agit : de Monsieur et Madame Lacroûte. Pas de chance pour eux, les cadeaux dans leur chute les malmenèrent. Lorsqu’il put s’en sortir, le couple couvert de bleus s’approcha d’Allumette pour lui demander pardon et proposer son aide. Une fois encore, l’héroïne d’un récit de Tomi Ungerer avait réussi à convertir des cœurs. Avec l’assistance des Lacroûte, la foule fut canalisée , les marchandises triées, puis entreposées dans un hangar appartenant au pâtissier.
Voyons comment s’achève le récit.
« L’entrepôt du pâtissier devint une ruche de dévouement où l’on s’activait de plus en plus. Des dons y arrivaient du monde entier et l’on envoyait des secours dans toutes les directions.
Partout où la famine, l’incendie, la guerre se déclaraient, il y avait des volontaires d’Allumette qui se dépensaient sans compter. »
Thérèse Willer fait observer que les illustrations de cet album sont « plus proches des cartoons et des dessins publicitaires réalisés à la même période, que de ses illustrations de livres pour enfants », tandis que Caroline Rives renvoie aux « peintres allemands de l’entre-deux guerre, Georges Grosz ou Otto Dix », peintres de la misère, des visages décharnés, des corps squelettiques et des horreurs de la guerre et de la vie.
La réception de ces albums
Comment ces albums qui ne plaisent pas aux parents furent-ils reçus par les enfants ? Nous avons heureusement des témoignages de bibliothécaires et de libraires. Je me permettrai de reprendre celui d’Annie Kiss :
« Il y a trois ans, (d’après mes calculs, c’était en 1978), je fus sollicitée par une école maternelle du quartier pour venir tenir un stand de la bibliothèque dans une salle de classe, à l’occasion de la fête de fin d’année. Je devais me tenir à la disposition des enfants pour leur présenter des livres, lire et regarder avec eux les livres d’images apportés de la bibliothèque et, bien sûr, raconter des « histoires ».
Je fis un choix de 125 livres d’images environ et quelques livres de contes, et je n’oubliai pas, bien entendu, les albums de Tomi Ungerer pour lequel j’ai un faible certain. Tous ces livres furent exposés sur une grande table et le long de présentoirs autour de la salle. Les enfants allaient et venaient librement, feuilletant les livres à leur guise et les choisissant selon leur goût. Je n’avais pas privilégié (volontairement ) les livres de Tomi Ungerer, connaissant l’impact qu’ils ont généralement sur les enfants, mais c’était presque toujours ceux-là que les enfants, même les très jeunes, apportaient. Je finis par les mettre dans les endroits les plus inaccessibles, les cachant presque pour rendre l’expérience plus concluante. Cela n’empêcha pas les enfants, petits et grands, de les trouver, de les choisir, et de me demander de les lire avec eux, et je passai presque toute ma journée, à ma plus grande joie d’ailleurs, penchée sur Le Géant de Zéralda, Les Trois Brigands, ou Guillaume l’apprenti sorcier.
Ces albums ont le grand mérite, poursuit Anne Kiss, de convenir à tous les âges, et ils sont pour nous, bibliothécaires, d’un grand secours lorsque nous devons proposer des livres à des enfants en retard scolaire et dont la maturité n’est plus en accord avec le niveau de lecture.
Les sujets traités, loin d’être puérils, la truculence du trait et l’humour sarcastique de Tomi Ungerer retiennent l’attention et enchantent unanimement les enfants jusqu’à un âge considéré comme ayant dépassé le stade du livre d’images. »
La Grosse Bête de Monsieur Racine et Le Chapeau volant
Truculence du trait, sensualité des formes, humour sarcastique, plaisir du gag et de la farce, bonheur de transgresser les limites du cadre des images ou les limites comportementales…
La Grosse Bête de Monsieur Racine
Explicite à cet égard : La Grosse Bête de Monsieur Racine, paru en 1971 aux Etats-Unis, et en 1972 à L’école des loisirs. Certaines analyses tout en soulignant l’humour enfantin de cet album qui raconte une bonne farce jouée par deux enfants à un brave homme solitaire et quelque peu naïf, receveur des contributions directes, en retraite, et ancien cavalier dans l’armée… qui adorait ses poires.
Certaines analyses vont jusqu’à considérer cet album comme « le premier livre pornographique pour enfants ». Ce sont les termes qu’emploie R. A. Siegel dans un article paru dans la revue américaine « The Lion and the Unicorn ».
Même si la tête de la grosse bête elle-même peut être interprétée comme un symbole phallique (cf. la quatrième de couverture), je verrais quant à moi, derrière le canular, un album paradoxal. A la fois un regard sévère sur une société qu’un rien suffit à dérégler et, en même temps, une forme de célébration du désordre et des excès.
Excès dans le maraudage des enfants qui ne laissent qu’une seule poire sur l’arbre de Monsieur Racine, excès dans l’affection débordante de Monsieur Racine pour la Grosse Bête, excès de vitesse lorsque Monsieur Racine enfourche son tricycle à moteur, dérèglement à la gare, où l’on boit avec excès, vétusté du matériel lors de l’embarquement de la cage de « l’animal » sur le wagon de la SNCF, enthousiasme ridicule, lors de l’arrivée du train à Paris : musique militaire, chorale, reporters et présence du Président du Conseil Municipal, chaos à l’Académie, au moment où les enfants éclatent de rire en mettant en pièce la Grosse Bête. Je vous invite à regarder avec attention la pagaille dans ce milieu scientifique et universitaire, souvent figé dans son honorabilité.
Regardez avec attention le déchaînement des académiciens et des quelques femmes présentes. Que laissent supposer les bretelles de pantalon qui valsent en l’air, de même que les lunettes, derrière l’amphithéâtre !
Voyez cette blonde qui cajole l’un des policiers appelés à la rescousse, ou cette montre qui fend le crâne d’un barbu, tandis qu’une respectable sommité tire sur l’élastique d’un lance pierre… comme un gamin, et qu’une autre sommité en costume noir et cravate, comme ses chers collègues, fait un pied de nez… comme s’il était dans une cour de récréation. Et j’en passe, le stylo planté dans le nez d’une femme, la perruque que perd une autre, la chaussure qui se détache d’une jambe de bois…
Voyez enfin la dernière double page qui met en scène, en une image fourmillant de détails, la bagarre qui s’engage parmi la foule des curieux. Et, comme le dit le texte, voyez les « actes inqualifiables » qui sont commis.
Arrêtons-nous sur cette image qui rappelle le grotesque d’Albert Dubout ou la richesse d’un tableau satirique de James Ensor.
Une bonne femme balance un pot de chambre sur la foule, un gars fesse un autre avec une raquette de tennis, une petite vieille chatouille le ventre d’un ventripotent aux gros bras en train de descendre une bouteille, un chauffard en Citroën fonce dans la foule… Le monde chavire et bascule comme les obliques qui structurent visuellement ce charivari plein d’humour.
Mais par-delà, l’histoire se termine harmonieusement.
« Monsieur Racine qui avait le sens de l’humour, trouva la farce à son goût. Après avoir félicité les enfants, pour leur ingéniosité et leur endurance, il leur fit faire un tour dans la capitale. Puis ils rentrèrent tous à la maison et les enfants furent rendus à leurs parents, de braves paysans qui habitaient de l’autre côté de la forêt. L’année suivante, Monsieur Racine eut une nouvelle récolte de poires qu’il fut tout heureux de partager avec ses deux jeunes amis. »
A ce propos j’aime beaucoup l’une des réflexions de Thérèse Willer qui fait remarquer – je cite – qu’en faisant l’éloge final de l’espièglerie des enfants qui sont les héros de l’histoire, il (Tomi Ungerer) rompt définitivement avec la tradition « punitive » des moralistes du XIXe siècle comme Wilhelm Busch dans son fameux Max et Moritz. Max et Moritz presque présents dans l’album, tant les deux enfants leur ressemblent.
Le Chapeau volant
J’attirais votre attention sur le pied qui se détache d’une jambe de bois, lors de l’assemblée générale de l’Académie des Sciences. Et bien, Tomi Ungerer a consacré un album entier à un ancien combattant, à la jambe de bois.
Faut-il rappeler que le petit Tomi fut drôlement marqué par la guerre comme on le voit dans ses dessins d’enfance présentés et commentés dans A la guerre comme à la guerre, un ouvrage publié aux éditions de La Nuée bleue à Strasboug, en 1991.
Peu gâté par la vie, puisque la guerre l’a privé d’une jambe, Benito Badoglio se débrouillait tant bien que mal aux marges de la société. Un peu seul ! Jusqu’au jour où la chance lui sourit, sous la forme d’un chapeau volant. Le Chapeau volant est sorti aux Etats-Unis en 1970 et en France en 1971.
Le chapeau est souvent associé à la magie ; les magiciens n’ont-ils pas l’habitude d’en sortir un lapin et bien d’autres choses parfois ? Dans notre album, le chapeau volant au nœud rose qui se posa sur le crâne chauve de Benito Badoglio était, bien sûr, magique. Et Benito, qui n’était pas sot, s’en aperçut immédiatement.
Ce chapeau volant, dévoué et obéissant, va permettre à l’invalide de guerre d’accomplir une série d’exploits en tirant pas mal de gens d’un mauvais pas. Parallèlement, Badoglio recueille les fruits de son dévouement grâce auxquels il perfectionne sa prothèse en la dotant d’une roulette d’argent, puis il achète de « beaux vêtements assortis à son chapeau » .
Lors d’un sauvetage périlleux, Benito fit la connaissance d’une comtesse à laquelle il offrit peu après un bouquet de roses. Elle devint amoureuse et ils s’épousèrent. Alors qu’ils roulaient en direction de la Sardaigne, pour un merveilleux voyage de noce, le chapeau s’envola… L’album se termine comme il avait commencé, c’est un chapeau que le vent emporte… A qui sourira la chance et la magie ? Qui sera capable de saisir la chance et d’aider les autres grâce à la magie ?
L’album n’a pas connu le succès espéré.
Quoique les gags burlesques qui se succèdent à un rythme rapide soient très amusants…
Quoique s’y manifeste très explicitement le goût de Tomi Ungerer pour les citations. C’est dans ce livre qu’il fait écho au film de Serguei Einsenstein, Le Cuirassé Potemkine. Il s’approprie la célèbre scène du massacre sur les marches de l’escalier monumental d’Odessa, scène au cours de laquelle un landau qui a échappé aux mains d’une maman dévale la pente…
Quoique les dessins y soient d’une très grande expressivité, avec pour décor des paysages italiens, conformément au nom provocateur du héros, Benito renvoyant à Mussolini et Badoglio à un maréchal italien de la guerre d’Ethiopie, comme le fait observer Claire Hicher.
C’est d’ailleurs là une habitude, chez Tomi Ungerer, de choisir pour ses personnages des noms évocateurs pour lui, sans lien apparent avec le déroulement du récit. Ainsi « Tiffany » dans Les Trois Brigands, réminiscence probable du nom de la famille et de l’entreprise Tiffany qui excella dans un design apparenté aux mouvements « Arts and Crafts » puis « Art Nouveau ». Ainsi « Zéralda » est une reprise du nom du camp d’entraînement, en Algérie, où le méhariste Ungerer avait effectué son service militaire.
Guillaume l’apprenti sorcier
Dans cette première série d’albums que nous venons de lire ensemble, série apparentée à des contes, le merveilleux et la magie jouent un rôle important. C’est encore le cas dans Guillaume l’apprenti sorcier d’après Goethe. Cette fois, nous devons l’adaptation du conte à Barbara Hazen et Adolphe Chagot.
Guillaume voudrait se prélasser, jouir du plaisir de jouer de la flûte et contempler le Rhin qui coule au pied du château où il est apprenti sorcier. S’il aime la magie, il trouve que son maître exagère en lui imposant d’inutiles corvées. Pourquoi l’envoie-t-il, en bas de la montagne, puiser l’eau pour remplir la cuve, alors qu’il suffirait d’une formule pour que le boulot soit fait ?
Un jour, profitant du départ de son maître convoqué à une réunion de sorciers, Guillaume trouve le moyen de se faire remplacer par un balai. Le balai fit merveille.
« Il sortit par la porte du château et descendit le rapide escalier de pierre jusqu’au Rhin. Arrivé au bord du fleuve, il se pencha, emplit le seau, puis il fit demi-tour et, par petits sauts, remonta l’escalier. »
Tout se passait bien, à la grande joie de Guillaume, jusqu’au moment où la cuve remplie se mit à déborder. Ignorant la formule magique qui aurait permis d’arrêter le balai, Guillaume fut pris de panique ; il saisit une hache et brisa le balai. Mais, ô horreur, chacun des morceaux devint balai et tous se mirent à monter des sauts pleins d’eau.
« Il y eut partout de l’eau qui tourbillonnait, tournoyait, s’enflait en trombe. Le flot se précipitait en bouillonnant, emportant les animaux, submergeant les meubles et les mettant en pièces. »
Guillaume appela son maître, craignant d’être noyé. « Ne me punissez pas » implora-t-il, à son arrivée. Pan ! Pan ! Pan ! Pan ! Quatre coups de balai bien appliqués sur les fesses et Guillaume fut expédié dans l’escalier avec son seau. « La cuve était vide, il fallait la remplir.»
Ce qu’il y a d’amusant dans la mise en scène de cet album, c’est que Tomi Ungerer a pu se déchaîner. On se croirait sous les voûtes gothiques d’un musée des horreurs, avec une momie ficelée, un monstre enfermé sous l’escalier, une touche de sadisme avec le buste d’une femme, Zéralda, au visage caché et portant un collier de soumise, des crânes humains, des alambics, des cornues, des pierres phosphorescentes, des mortiers, des animaux inquiétants, chauve souris, hibou, pieuvre, araignée, méduse et des flacons qui dégagent des nuages de fumée colorée dans lesquels je me refuse à sentir, comme l’affirme Caroline Rives, un fourmillement de pets.
Comme dans un train fantôme, humour de mauvais goût et horreur de convention voisinent. Voyez un dentier et une brosse à dent, dans cette image où, sur les bords de la cuve, se prélasse une pieuvre ! Voyez Guillaume jouer avec les petits serpents verts et s’amuser à les nouer
Les successeurs se feront nombreux, fantômes, squelettes, bestioles dégoûtantes ou effrayantes raviront les amateurs de sensations fortes. En 1979, paraît l’un des best-sellers de l’horreur, Haunted House de Jan Pienkowski, ce pop up sera immédiatement traduit en France, chez Nathan, sous le titre La Maison hantée.
Ces albums ont fait la célébrité de l’artiste. Leur succès international ne se dément pas. Aux enfants qui n’ont cessé de l’apprécier se sont joints les adultes peu à peu convertis. Entre temps, son œuvre a été couronnée par le Prix Andersen, considéré comme le Prix Nobel de la littérature de jeunesse. Il faut reconnaître par ailleurs que le paysage éditorial a beaucoup changé, en quelques années, et que nombre de tabous sont tombés. Sans doute sous son influence et celle de quelques autres.
Crictor, Adélaïde, Emile, Orlando
Comme, après la publication d’Allumette, Tomi Ungerer ne créait plus en direction de l’enfance, L’école des loisirs s’est tournée vers des livres plus anciens.
En 1978 et au début des années quatre-vingts, la maison de la rue de Sèvres publia dans sa petite collection « Renard poche », qui se muera en « Lutin poche », Crictor (paru chez Harper and Brothers à NewYork en 1958), Adélaïde (1959), Emile (1960) et, dans la même veine, Orlando (1966).
Lors d’une interview, répondant aux questions d’Arthur Hubschmid, Tomi Ungerer, commentant ces albums, explique : « Tous ces animaux qui sortent de l’ordinaire sont très intéressants d’un point de vue pédagogique, pour montrer aux enfants que, même s’ils n’ont qu’une jambe, ou un défaut, ils pourront toujours s’en sortir dans la vie. Tu vois ce que je veux dire ? »
Pour confirmer qu’il a bien compris, l’ami Arthur précise : « En fait, tu as pris des animaux réputés désagréables, répulsifs, et tu les as rendus sympathiques.»
Réponse de Tomi : « Oui, je les ai réhabilités. »
Et il est vrai qu’il serait difficile de trouver plus agréable compagnon qu’Emile. Nous nageons ici en pleine fantaisie. Emile la pieuvre, comme le sera plus tard Benito Badoglio, est un véritable ange gardien qui secourt qui est en danger, qui se révèle être un excellent musicien, un défenseur du bon droit. Et un ami fidèle.
Adélaïde (héros du livre qui a été réédité en format album en 2008, comme celui d’Orlando) est un kangourou mutant, un véritable phénomène. A sa naissance, elle portait des ailes ! Grâce à celles-ci, Adelaïde découvrit le monde, de l’Inde à Paris. Mais, surtout, elles lui permirent de sauver deux enfants qui se trouvaient dans une maison en feu.
Avec Orlando, nous sommes transportés au Mexique. Un vautour sympathique et courageux y accomplit de nombreux exploits. Grâce à lui, le petit Finley retrouve son père, un chercheur d’or américain égaré dans le désert. Les péripéties s’enchaînent et Tomi Ungerer s’y révèle un maître de la mise en page en même temps qu’il tire un superbe parti des deux couleurs qu’il utilise, le rouge et surtout le brun, tantôt fonçé, tantôt clair.
Tomi Ungerer travaille ici le trait à l’encre de Chine, comme beaucoup d’illustrateurs américains, dans les années cinquante.
La Famille Mellops
En même temps qu’Arthur Hubschmid édite le cycle des bonnes actions des animaux humanisés, il fait connaître les premiers livres pour enfants de Tomi Ungerer qui étaient sortis chez Harper nand Row dont le département jeunesse était dirigé par l’une des grandes éditrices américaines, Ursula Nordstrom, qui publia Margaret Wise Brown, E.B. White, Crockett Johnson, Ruth Krauss, Maurice Sendak…
Les Aventures de la famille Mellops ont été rassemblées en un volume par L’école des loisirs en 2008. Pour présenter cette série, je vais m’effacer devant Thérèse Willer : « Autour des Mellops, une famille de joyeux petits cochons humanisés à l’allure française, Ungerer a imaginé des aventures rocambolesques comme la recherche d’un trésor, de pétrole, la quête d’un sapin de Noël et des fouilles spéléologiques. Les Mellops présentent un modèle de famille très conventionnelle, dont la figure de la maman, une femme au foyer, déplut particulièrement aux féministes américaines de l’époque (…). L’influence de Babar de Jean de Brunhoff qui avait été l’un des livres de chevet du jeune Tomi y est encore très perceptible sur le plan graphique. Le trait linéaire à l’encre de Chine et les couleurs pastel des lavis donnent de la fraîcheur à ces premiers dessins qui ne sont cependant pas dénués d’un ton satirique, esquissant une critique de la société de consommation. Le motifs des petits cochons se prête d’ailleurs bien au dessin d’humour (…). »
De 1997 à 2007
Alors qu’il avait douté « de la nécessité de continuer », Tomi Ungerer reprend du service avec Flix en 1997, Tremolo en 1998, Otto en 1999, Le Nuage bleu en 2000, Ami-Amies en 2007.
La différence et le respect de l’autre, la tolérance sont au cœur de ces albums, des thèmes chers à Tomi Ungerer.
Attardons-nous quelque peu à Flix.
La couverture est aussi forte qu’une affiche. Tomi Ungerer maîtrise admirablement l’art de la communication. Derrière la couverture de ce chien se profile une ombre de chat. Notre curiosité est en alerte. La première image nous entraîne dans un univers feutré, chez Monsieur et Madame Lagriffe qui s’aiment d’autant plus tendrement que le ventre d’Alice s’arrondit. A l’écran de télévision, par contre, une scène de violence : un chat masqué poursuit un chien, en brandissant une hache. Eternelle histoire de l’hostilité entre les deux espèces animales.
La surprise est grande lors de l’accouchement :
« C’est un garçon » ! annonça-t-on au papa.
Théo Lagriffe est fou de joie. On l’autorisa enfin à aller voir sa femme, qu’il couvrit de fleurs et de baisers. Puis ils regardèrent le bébé. Il avait un petit visage aplati, tout fripé, des bajoues et de minuscules oreilles pendantes.
« Comme il est mignon ! » susurra maman Lagriffe.
« Mais… mais… c’est un chien ! »
« Et alors ? »
La presse se scandalisa, mais il fallut se résoudre à l’évidence et accepter ce caprice de la nature. Peu après l’enfant fut baptisé, avec pour parrain, un vieil ami de la famille, Médor Klops, un basset, qui habitait Clébardville. Le texte d’Ungerer est d’une grande saveur pour raconter le métissage entre culture chat et culture chien.
Je ne peux résister au plaisir de la citation, à cette attention aux langues de Tomi Ungerer qui apprit le français, l’allemand, l’alsacien et puis l’américain, et qui vécut au Canada et en Irlande.
« Flix grandit. Il était joyeux, gentil et vif.
Ses parents lui apprirent la langue des chats qu’il parlait avec un accent chien. Sa mère lui lima les ongles en pointe et lui apprit à grimper aux arbres. Souris grillées, coulis de canari ou hot dog, Flix adorait ce que sa maman lui préprait. Et il ronronnait quand il s’endormait sous ses chatouilles. »
Et la suite est aussi belle : « Le dimanche, on pique-niquait ensemble au bord de la rivière. Oncle Médor apprenait à nager à Flix et il lui enseignait la langue des chiens. Flix la parlait avec un léger accent chat. »
Et l’auteur d’ajouter entre parenthèse et en italiques : (Autrefois, les chiens parlaient chien et les chats parlaient chat. Ils se comprenaient mais personne ne comprenait la langue de l’autre.)
On imagine aisément qu’à Chatville, Flix rencontra des difficultés d’insertion sociale. Pas facile pour un enfant chien de vivre parmi les enfants chats. Toujours cette différence ! Et cette incompréhension. Aussi, Flix fit-il sa scolarité à Clébardville où il se révéla un brillant élève et brillant musicien.
Comme souvent dans les récits de Tomi Ungerer, le héros est amené à sauver quelqu’un. Flix, en week end chez ses parents, repêcha un matou qui se noyait. La nage que lui avait appris son parrain se révélait très utile, comme un plus tard l’art de grimper aux arbres à la façon des chats. Cet art lui permis de sauver une jeune chienne d’un incendie. Flix et Mirzah tombèrent immédiatement amoureux l’un de l’autre. Leur mariage fut l’événement de l’année dans une église où chiens et chats communièrent dans l’allégresse. Aux aboiements des chiens devaient se mêler les miaulements des chats tandis que deux prêtres, un chien et un chat, présidaient la cérémonie.
« Flix fit son entrée en politique.
Il fonda l’UCC, l’Union des Chats et des Chiens, un nouveau parti qui militait pour des écoles mixtes, un respect mutuel et les mêmes droits pour tous ! Lorsqu’il fut élu maire des deux villes, Mirzah lui murmura un secret dans le creux de l’oreille. « Chéri nous serons bientôt trois ».
Je vous laisse deviner la suite.
« MIAOU ! »
Le message est évident. « Apologie du métissage, Hymne au respect mutuel », a-t-on écrit. Si le propos nous réjouit, sachons qu’il reste dérangeant pour pas mal de monde.
Par-delà le texte superbe dans son alternance de narration et de dialogues , par-delà le rapport texte/images et la mise en page qui soutiennent le rythme du récit, il reste à découvrir un véritable festival de détails. Tomi Ungerer s’est bien amusé.
Il s’amuse à intriguer en disposant des robinets çà et là : à la télévision, à l’échelle qui monte dans l’arbre, à la table de billard, au livre de l’écolier en face du maître. Il s’amuse à choquer les braves gens. C’est avec un arrosoir que Flix est baptisé par un chat mitré et, comme il se doit, à l’église où le mariage est célébré trône une statue de saint Bernard : jeu de mot et jeu d’image. Et l’on pourrait poursuivre en s’amusant des flûtes de l’orchestre symphonique de Clébardville et surtout du musicien du fond qui allume un pétard. Et qui a lu les albums antérieurs se réjouira de voir des saucisses, de la boisson en abondance, des bouquets de roses…
—————————————————-
En guise de conclusion à sa conférence, Michel Defourny lut un extrait d’Otto, autobiographie d’un ours en peluche qui venait de paraître à L’école des loisirs. Un grand moment d’émotion ! Un grand moment de recueillement !
Merci, Tomi Ungerer.